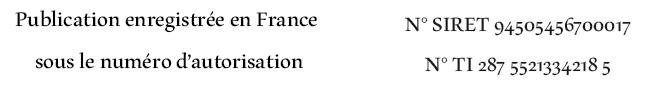Trump ordonne la levée des sanctions américaines contre la Syrie après 45 ans d’embargo
Cinq mois après la chute d’un régime d’autocratie brutale qui perdurait depuis des décennies, les Syriens célèbrent à nouveau. Mardi, le président Donald Trump a annoncé la levée des sanctions américaines imposées à la Syrie depuis plus de quarante-cinq ans.
« Toute ma famille est descendue dans la rue, » confie Nedal al-Amari, activiste originaire de Daraa et installé en Allemagne, à Middle East Eye. « Il y a eu d’immenses festivités dans toutes les villes syriennes. »
Depuis la déchéance du gouvernement de Bachar al-Assad, le 8 décembre, la nouvelle administration syrienne dirigée par Ahmed al-Sharaa peine à redresser une économie ravagée par la guerre et asphyxiée par les sanctions. Si l’Union européenne et le Royaume-Uni ont partiellement allégé certaines mesures en début d’année, Washington les maintenait encore en vigueur.
En mars, les États-Unis ont formulé plusieurs exigences à Damas pour amorcer un processus de levée des sanctions, parmi lesquelles l’interdiction de toute activité politique palestinienne et l’unification de l’armée syrienne — démarches déjà amorcées par le nouveau pouvoir. Beaucoup prédisaient des négociations à rallonge, mais, lors de son voyage en Arabie saoudite, Donald Trump a surpris en annonçant : « J’ordonnerai la cessation des sanctions contre la Syrie afin de lui donner sa chance pour parvenir à la grandeur. »
« Toutes les sanctions seront levées, » a-t-il déclaré, soulignant l’influence exercée par le prince héritier saoudien et le président turc. « Je souhaite bonne chance à la Syrie. Montrez-nous quelque chose de spécial. »
Un héritage de sanctions
Les premières sanctions américaines contre la Syrie remontent à 1979, sous le règne de Hafez al-Assad : classement de la Syrie parmi les « États parrains du terrorisme », restrictions financières, embargo sur l’aide étrangère et interdiction d’exportations d’armements. L’administration Reagan renforça ces mesures en 1986, notamment en interdisant aux avions syriens d’atterrir sur le sol américain.
En 2004, l’administration Bush fils accusa Damas de détenir des armes de destruction massive, de soutenir des groupes militants (Hezbollah, Hamas) et de déstabiliser l’Irak et le Liban, ce qui entraîna de nouvelles limitations des échanges économiques et le gel des avoirs de plusieurs individus et entités.
Les sanctions les plus lourdes ont été adoptées après la répression sanglante des manifestations pacifiques en 2011, qui a plongé le pays dans la guerre civile. L’UE gela les avoirs de responsables liés à l’État et interdit l’import-export de secteurs jugés sensibles (technologie, pétrole, gaz), tandis que les États-Unis interdirent tout lien commercial, sauf pour l’alimentation et les médicaments. En 2019, le « Caesar Act » instaura des sanctions secondaires visant à pénaliser les sociétés étrangères commerçant avec des entités syriennes sous embargo.

Conséquences sur la vie quotidienne
« Les sanctions ont surtout empêché l’économie de se relever des destructions causées par la guerre, » explique Benjamin Feve, spécialiste de l’économie politique syrienne. Infrastructures d’eau, d’énergie, transports et services de base — chauffage, électricité, déplacements — sont en grande partie hors service. Les secteurs de la santé et de l’éducation ont également souffert.
Malgré des exemptions humanitaires, la complexité des régulations a dissuadé de nombreuses banques et organisations de traiter avec la Syrie, freinant l’acheminement de l’aide et l’accès aux services essentiels. Résultat : plus de 90 % des 23 millions de Syriens vivent sous le seuil de pauvreté, l’économie a rétréci de 84 % entre 2010 et 2023 et la livre syrienne s’est effondrée, passant de 47 livres pour un dollar avant la guerre à près de 13 000 sur le marché noir début 2025.
Quels chantiers pour la nouvelle administration ?
Privée de ressources financières, la récente administration d’al-Sharaa reste impuissante à engager les réformes institutionnelles et économiques nécessaires. « Une économie sous sanctions ne peut fonctionner, et un gouvernement sans argent est un gouvernement impuissant, » souligne Feve. Il faudra d’urgence rétablir l’électricité, l’approvisionnement en pétrole et en essence, équiper les hôpitaux et relancer l’éducation et l’emploi.
L’ONU estime à 250 milliards de dollars le coût de la reconstruction, mais ce chiffre pourrait être revu à la baisse selon des experts, qui misent sur la volonté populaire de rebâtir. L’Europe et les pays arabes devraient en être les principaux financeurs, faisant basculer l’aide d’humanitaire à développement.
Reste à savoir exactement quelles sanctions seront levées : nombreuses restent encore en place, certaines datant de 1979. Le statut de Hayat Tahrir al-Sham, dissous depuis, pourrait être réexaminé, tout comme la désignation d’al-Sharaa, désormais fossoyeur de la polarisation, surtout après sa poignée de main avec Trump, qualifié de « jeune homme charismatique au passé fort ».